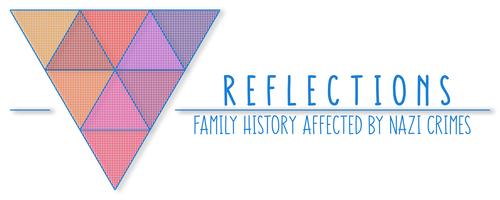© S. van der Goot-Dresselhuis
Il y a quelques années, on m’a demandé si j’étais une petite-fille du résistant Willem Dresselhuis. La question m’était posée par un écrivain qui voulait écrire un livre sur l’Oldambt dans la province néerlandaise de Groningue pendant la guerre. Il m’a demandé des informations sur mon grand-père, arrêté le 15 avril 1944 car il faisait partie d’un groupe de résistance. Cette question a suscité des recherches sur mon grand-père et il est vite apparu que ce lointain passé avait influencé l’attitude adoptée par Willem Dresselhuis pendant l’occupation allemande des Pays-Bas. La décision de s’opposer au régime nazi semble avoir été en partie déterminée par l’histoire familiale. Pour pouvoir me faire une idée précise de mon grand-père, j’ai dû remonter loin dans le passé.
L’origine de la famille Dresselhuis à Schale, dans le comté de Tecklenburg, en Allemagne
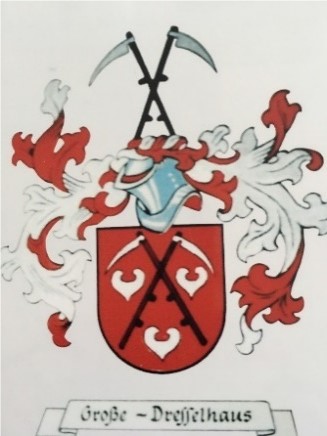
© S. van der Goot-Dresselhuis
La famille Dresselhuis est d’origine allemande. Ses origines se trouvent à Schale, qui a appartenu à Tecklenburg jusqu’au début du 18e siècle, date à laquelle elle a été vendue à la Prusse. Cette nouvelle appartenance avait considérablement changé l’atmosphère dans la région. Les anciennes traditions étaient interdites et les hommes devaient effectuer un service militaire. Les Prussiens étaient détestés dans la région. Les jeunes hommes passaient la frontière de l’Empire prussien pour échapper à la conscription. Cela a été également le cas des fils de Hermann Große Dresselhaus (1686-1733). Un de ses fils était notre ancêtre. Il s’est installé à Fürstenau en Basse-Saxe et est devenu le premier forgeron de cette ville de garnison. Il avait un fils et deux filles. Après la mort de leurs parents, le frère et les deux sœurs ont quitté à leur tour Fürstenau et devaient avoir plusieurs raisons de le faire. Les changements sur le trône prussien en 1740 rendaient l’avenir incertain. On craignait que les Prussiens envahissent aussi la Basse-Saxe. De plus, la famille vivait dans une région pauvre avec peu de perspectives d’avenir. Depuis le Moyen Âge, à Emden, les échanges avec le pays voisin, les Pays-Bas de l’autre côté de l’Ems étaient nombreux. La République des Pays-Bas était beaucoup plus riche et les libertés plus nombreuses. Il y avait beaucoup de travail et de nombreux habitants déjà partis en République néerlandaise pour un travail saisonnier racontaient à leur retour des histoires enthousiastes.
La République des Pays-Bas

Le frère et ses deux sœurs se sont rendus à Winschoten, une ville au milieu des landes, dans le nord de la République des Pays-Bas, près de la ville commerçante de Groningue, où la population parlait presque la même langue qu’en Westphalie. Il y avait beaucoup d’émigrants allemands à Winschoten. La ville se trouvait au début de son apogée et les possibilités de réussir étaient nombreuses. Les hommes de la famille étaient forgerons de père en fils. Le fils aîné héritait de la forge et les autres fils construisait une forge dans un village voisin. Finalement, plusieurs forgerons ont eu des descendants dans la lignée Winschoten-Drieborg. C’est à Drieborg, à la frontière allemande, qu’est né le résistant Willem Dresselhuis. Les deux pays étaient séparés seulement par un fossé, même la langue parlée était la même des deux côtés de la frontière. De nombreux contacts existaient et on ne se considérait pas comme deux nations, mais comme une seule et même région. De nombreuses personnes se sont mariées, ont travaillé dans le pays voisin et y sont même allées à l’église. Il n’y avait pas de haine vis-à-vis des Allemands, mais à l’égard des Prussiens. La population détestait en particulier leur culture politique militariste : la discipline, l’obéissance aveugle et le claquement des bottes, l’expansionnisme et l’asservissement des populations locales.
Le régime hitlérien présentait de nombreuses similitudes avec le comportement détesté des Prussiens. Après la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle les Pays-Bas étaient restés neutres, nombreux devaient être ceux qui se sont probablement réjouis de la fin du régime prussien en 1919 et de la fondation de la République de Weimar. Malheureusement, il s’est vite avéré qu’un courant maléfique voulait prendre le pouvoir, pire que les Prussiens, qui avaient néanmoins apporté de bonnes choses comme une meilleure éducation, la science et la culture.
La période précédant la Seconde Guerre mondiale au Royaume des Pays-Bas
Vers 1900, les Pays-Bas ont traversé une crise et connu des émeutes causées principalement par les communistes. Les Pays-Bas ne semblaient plus être le pays idéal, l’histoire s’est répétée et trois des enfants de Dresselhuis ont émigré en Amérique. Les enfants restés aux Pays-Bas ont rapidement réussi. Avant la Première guerre mondiale, la forge était devenue une fabrique de bicyclettes. L’entreprise se développait et, en 1922, l’usine et une maison jumelée ont été construites à Winschoten. Willem dirigeait l’entreprise avec son frère aîné. Willem s’occupait des ventes et voyageait pour les affaires aux Pays-Bas et dans de nombreuses régions d’Allemagne. Pour cette raison, il connaissait beaucoup de gens. La famille était bien au courant des événements politiques ; disposer d’informations était considéré comme très important. En outre, la famille était de confession protestante. Cette vision de la vie a déterminé son attitude lorsque Hitler est arrivé au pouvoir. Outre sa haine des régimes totalitaires, l’attitude des nazis envers certains groupes n’était pas compatible avec ses convictions.
Dans la ville natale de Willem, Drieborg, il y avait beaucoup de communistes. Il s’agissait de pauvres ouvriers agricoles exploités par de riches propriétaires. Depuis 1922, Willem vivait à Winschoten où il y avait environ 500 personnes juives – parmi elles beaucoup de pauvres, mais aussi beaucoup de riches et des personnes importantes. C’est sur ces groupes que Hitler a dirigé ses flèches. Aux Pays-Bas également, les communistes étaient considérés avec méfiance. On craignait qu’ils ne veuillent déclencher une révolution, comme cela s’était produit en Russie. La population juive avait ses propres règles religieuses qui étaient très différentes. Cela provoquait l’incompréhension et ce qui est inconnu est vite suspect.
La société néerlandaise comptait de nombreux groupes fermés, fondés sur des opinions politiques ou religieuses, qui cohabitaient sans problèmes majeurs. Selon la tradition néerlandaise, la liberté prime sur l’oppression des autres opinions.

© S. van der Goot-Dresselhuis
Mobilisation et invasion des troupes allemandes le 10 mai 1940
Pour les habitants de Groningue, il était difficile à croire que l’Allemagne attaque également les Pays-Bas. Ils avaient vu les camps de concentration à la frontière et ne pouvaient plus désormais se rendre en Allemagne. Depuis que Hitler avait pris le pouvoir, il y avait beaucoup de réfugiés à Winschoten qui avaient du mal à subsister. L’atmosphère était tendue. Les hommes étaient mobilisés et finalement l’invasion redoutée était devenue réalité. Un ultimatum a été posé : se rendre ou Rotterdam serait bombardée. Mais avant même l’expiration de l’ultimatum, les avions allemands ont décollé. De nombreux Néerlandais étaient très indignés et voyaient en cela un signe du manque de parole du commandement de l’armée allemande. Willem était aussi très en colère. Il était stationné près de Rotterdam où vivaient également sa sœur et ses neveux. Au lendemain du bombardement, il a vu la ville en ruines. Il a conduit la famille de sa sœur à Winschoten pensant qu’elle y serait plus en sécurité. Il a également appris que son cousin, avec qui il avait grandi et dont il était très proche, avait trouvé la mort dans une embuscade.
Un mélange d’amour de la liberté, de colère, de chagrin, de loyauté envers la reine et de boussole calviniste l’a conduit à lutter directement contre le régime d’Hitler. La plupart des Néerlandais tentaient de s’adapter à la situation et lorsque la population juive a été déportée, il y a eu peu de résistance à Winschoten.
De plus en plus de personnes voulaient résister et des groupes de résistance se formaient et fonctionnaient de mieux en mieux au fil de la guerre.
Pas un esclave

© S. van der Goot-Dresselhuis
Willem Dresselhuis était conscient du grand danger qu’il encourait et il a néanmoins continué de se battre en dépit d’une première arrestation en décembre 1942. Comme il l’a dit lui-même, « je préfère me battre jusqu’à la mort plutôt que de rester un esclave allemand ». Le service de sécurité a infiltré un mouchard et Willem a été à nouveau arrêté le 15 avril 1944. Les chefs d’accusation étaient : aide aux juifs, espionnage, possession d’armes et diffusion de presse clandestine.
Après 3 mois, il a été emmené au camp d’Amersfoort après être passé à Scholtenhuis, le siège du service de sécurité, et en octobre 1944 à Neuengamme. Jusqu’à son dernier souffle, Willem était convaincu de la victoire finale et, malgré les circonstances barbares, encourageait ses co-détenus et cela jusqu’à ce qu’il meure lui-même d’épuisement : comme esclave allemand, mais avec un esprit libre. Il s’était battu jusqu’à la mort.
L’approche et l’importance de la recherche
La partie précédente est un résumé de mes recherches intensives sur l’histoire de la famille. A l’origine, la raison était la question de l’auteur et le fait que je ne savais pas grand-chose de mon grand-père et de la famille en général.
Ma mère a raconté un certain nombre d’histoires sur le grand-père Willem, sur la résistance, les arrestations et sa mort dans le camp de Neuengamme. Mon père ne nous a jamais parlé de son père, à nous les enfants. Maintenant que tous les enfants de Willem Dresselhuis sont décédés, les petits-enfants peuvent regarder le passé de manière objective sans blesser leurs parents par des émotions dominantes.
Au début, je voulais seulement savoir quel rôle mon grand-père avait joué pendant la guerre. Mais je suis vite devenue curieuse de sa personne. Qui était cet homme et pourquoi avait-il pris ces décisions ? L’écrivain a entrepris des recherches dans les archives et a partagé avec moi les connaissances qu’il avait acquises. Cependant, cela ne donnait toujours pas une image précise de mon grand-père. La seule façon d’en savoir plus était de questionner les membres encore en vie de la famille. Il s’est avéré que nous disposions de beaucoup d’informations. Pour moi, mon grand-père devenait vivant ; je le voyais avant la guerre, sociable, généreux, intrépide, pas compliqué, déterminé, objectif, endurant, ouvert et très apprécié dans la famille et par ses amis. Il s’est également avéré que la famille entretenait des relations très étroites jusqu’à la fin de la guerre.
J’ai reçu une idée plus précise de mon grand-père, mais la question de savoir pourquoi il était entré dans la résistance n’a pas reçu de réponse complète. Pour cela, je me suis penché sur l’histoire familiale. Plusieurs recherches généalogiques existent sur cette famille. En comparant les données généalogiques avec les événements historiques de la région où vivaient mes aïeuls, une image claire des raisons de leurs actions a émergé. Les similitudes dans le comportement de mes lointains ancêtres et de mon grand-père étaient frappantes, à savoir ne pas accepter l’oppression et la coercition et assumer les conséquences de ce choix.
Mon père et les conséquences de la guerre

© S. van der Goot-Dresselhuis
Mon père avait 14 ans quand son père a été arrêté. L’arrestation a été traumatisante car elle s’est déroulée de nuit dans leur maison alors que lui et son petit frère (âgé de 7 ans à l’époque) dormaient. Leur père, Willem, s’était caché ailleurs pendant un certain temps, mais cette nuit-là, il était rentré sans que les enfants ne le sachent. Pendant l’arrestation, les membres du SD ont pénétré de force dans la chambre des garçons. Un pistolet a été placé sur le front du plus jeune et mon père devait dire où se trouvait son père. Mais il ne le savait pas. Le père, Willem, s’était réfugié sur le toit et il a été découvert après une longue recherche. Des munitions et un émetteur étaient cachés dans la cave, mais n’ont pas été trouvés. Pendant le couvre-feu, mon père a réussi à se rendre chez une connaissance à qui il a remis ces objets et qui les a cachés. En fin de compte, mon père peut aussi être considéré comme une victime de guerre de la première génération.
Pour de nombreux membres de famille de résistants, l’après-guerre a été terrible. La société ne les comprenait pas et l’on disait souvent que les résistants étaient eux-mêmes responsables de ce qu’il leur était arrivé. Ils voulaient laisser la guerre derrière eux et se construire un nouvel avenir. Le résultat est que de nombreuses familles de résistants aux Pays-Bas n’ont plus jamais parlé de la guerre. La guerre a eu un grand impact sur la vie de mon père. Mon père a fait son deuil pendant très, très longtemps et il a porté pendant des années le costume et la chevalière de son père, comme si cela le rapprochait de lui. Pendant la guerre, il devait cacher sa colère. Mais cette colère a refait surface dans sa vie de temps en temps. La colère était sa façon de supprimer ses sentiments. Il se sentait seul au milieu des personnes qui l’aimaient.
Il a travaillé dur comme pour prouver à son père, à titre posthume, qu’il était un fils digne de ce nom. Il a connu le succès, mais a évité les risques, tant sur le plan personnel que professionnel, son objectif étant de garder le contrôle. Mais la nuit, il ne pouvait pas contrôler ses rêves. Il ne pouvait pas se détendre au lit et faisait des cauchemars. Les conséquences de la guerre sont devenues plus évidentes lorsque son frère cadet (le plus jeune enfant) a souffert de psychose à l’âge de 60 ans et a revécu plusieurs fois l’arrestation. Il barricadait les portes et montait la nuit sur le toit. Toute sa vie, il avait occulté cet événement et maintenant il sortait enfin. Mon père a été épargné par ce sort, son esprit s’éteignant lentement à cause d’une démence vasculaire.
Toute sa vie, mon père a cherché des réponses dans les livres parce que personne ne voulait parler de la guerre. Il était souvent perdu dans ses pensées et inaccessible pour nous. Il a réussi malgré tout à garder la tête hors de l’eau. Il avait vu le pire et était heureux que ce soit derrière lui – ça ne pouvait qu’aller mieux.
Les conséquences sur ma génération
Toute la famille s’est disloquée après la guerre. Les différentes familles vivaient dans leur propre monde. Je savais très peu de choses sur l’histoire de ma famille, en particulier sur la période d’avant-guerre.
Pendant mon enfance, il y avait encore beaucoup de personnes à Winschoten qui avaient collaboré avec les nazis. Selon ma mère, mon père ne voulait pas nous confronter avec les malheureuses conséquences de la guerre. C’est pourquoi nous savions très peu de choses. Mais nous, les enfants, nous en subissions souvent les répercussions, il y avait une certaine ambiance et certaines personnes étaient mises à l’écart. Mais mon père nous a aussi appris que les Allemands n’étaient pas de mauvaises personnes, seulement les nazis et il le montrait ; il avait une voiture allemande (depuis 1960), allait souvent en Allemagne et regardait la télévision allemande. D’une manière ou d’une autre, nous avons toujours respecté les sentiments de mon père et nous l’avons beaucoup aimé, mais il était quand même en quelque sorte seul. Nous, les enfants, nous étions habitués à communiquer essentiellement de manière non verbale. Nous y étions habitués et considérions cela comme normal, comme tout ce qui entourait mon père. Maintenant je sais que ce n’était pas normal.
Depuis l’apparition de l’internet et l’ouverture des archives, la recherche est devenue plus facile. Sur le tard, de nombreux petits-enfants veulent trouver des réponses.
La recherche change la vision et guérit
Le fait qu’une expérience traumatisante devienne la référence dans la vie d’une personne et que la période précédant cet événement semble avoir été effacée peut créer un sentiment de déracinement. Mais les racines, comme celles d’un arbre, sont importantes pour le développement. Ces racines remontent également à l’époque d’avant la guerre et permettent de comprendre qui nous sommes et pourquoi certaines choses se sont produites.
Maintenant, nous avons une image globale de la famille et il en ressort que les membres de la famille Dresselhuis possèdent, depuis des générations, de nombreuses caractéristiques communes et qu’ils n’ont jamais pris le chemin le plus facile. Au contraire, ils ont toujours écouté leur conscience et leurs convictions – la liberté a joué un rôle majeur.
L’un des effets secondaires de mes recherches a été de resserrer les liens avec la famille qui vit dispersée aux Pays-Bas. Grâce à ces recherches, j’ai appris à connaître mon grand-père, ma famille et mes ancêtres. Cela fait du bien et cela guérit. Je me sens proche d’eux, faisant partie de quelque chose de plus grand. Je suis fière de leur attitude dans les moments difficiles et j’espère avoir hérité de ces qualités. Le mal ne disparaîtra jamais et l’histoire semble toujours se répéter. Il faut tirer les leçons des événements historiques pour prendre les bonnes décisions quand c’est nécessaire.
Sources :
- Familieboek Visscher ; titre : Kornelius Visscher, Aaltje Visscher-Dresselhuis en hun familieleden ; BG NL012689 ; uitgifte 2006, door A. Hamming-Visscher, B Hamming.
- Famille Dresselhuis ; J. Giezen, Groningen 1997 ; cf. Genealogie-CBG 4 (1998), nr. 3, p 74.
- Histoire du district de Tecklenburg ; Friedrich Ernst Hunsche (1905-1994)
- Politiecommissaris van den Hof en het Scholtenhuis deel I und II, Foppe Walters 2020
- Gedenkboek verzetsherdenkingskruis 1985 ; prix national créé le 19 décembre 1980 à l’occasion du 35e anniversaire de la libération par décret royal (n° 104). Ce prix est destiné aux participants à la résistance contre les occupants du territoire néerlandais pendant la Seconde Guerre mondiale.
Traduit par Annick et Christine Eckel