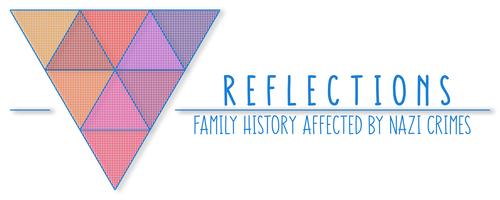La grande sœur de ma grand-mère

© Wolfgang Zabrzynski
En 1985, les deux dernières lettres de détention d’Elisabeth Sztwiertnia, ma grand-tante, datant de 1944, me sont tombées pour la première fois entre les mains. Elle était la grande sœur de ma grand-mère Maria Zabrzynski. Auparavant, on disait toujours qu’elle était morte à Berlin dans un bombardement.
Mais son destin était devenu un secret de famille, car son assassinat par le tribunal du peuple national-socialiste ainsi que l’expérience de la guerre et de l’expulsion de ce qui était alors le Sudetengau avaient traumatisé sa sœur (ma grand-mère) et ses proches. Ce n’est que petit à petit que ma grand-mère a pu me raconter des bribes de la véritable histoire et j’ai trouvé le reste dans les dossiers de procès dans les Archives fédérales.
Ma grand-tante Elisabeth Sztwiertnia est née le 26 mars 1905 à Troppau (l’actuelle Opava), fille de Franz Sztwiertnia et de sa femme Maria Fiala. Deux ans plus tard, sa sœur Maria (ma grand-mère) est née, également à Troppau. Franz Sztwiertnia est mort déjà en 1909 et sa femme en 1915, alors les deux filles sont tôt devenues orphelines et ont reçu un tuteur. C’est notamment pour cette raison qu’Elisabeth s’est sentie toute sa vie responsable de sa sœur cadette.
Une enfant joyeuse qui aimait les animaux

© Wolfgang Zabrzynski
Elisabeth était probablement une enfant joyeuse. Après cinq ans d’école primaire et trois ans de « Bürgerschule », elle a fréquenté l’école de commerce de Troppau dans les années 1920. Selon les souvenirs d’une camarade de classe datant de juillet 1985, elle était toujours prête à faire des blagues et il y avait toujours quelque chose qui avec elle faisait rire. Elle aimait particulièrement les animaux. Des photos la montrent enfant avec sa petite sœur Maria et son chien Schipsel, avec la chèvre d’une connaissance et plus tard avec le chat d’une amie. Plus tard, elle avait un petit chien nommé Batzi. Dans ses demandes de grâce, elle mentionnait qu’elle était engagée dans la protection des animaux. Après l’école de commerce, Elisabeth a travaillé à Vienne pour un journal cinématographique en tant qu’employée de bureau et, à partir de 1926, à Berlin pour l’entreprise juive Fromm comme caissière. En 1929, elle est retournée à Troppau. De 1932 à 1938, Elisabeth est employée comme correspondancière par l’entreprise juive Silesia et entretient une relation amoureuse avec l’ingénieur juif Viktor Potaravsky de Brünn, l’actuelle Brno.
Vivre sous la terreur du national-socialisme
Ainsi à partir de 1938, après le rattachement au Reich allemand, Elisabeth a dû subir directement la terreur des nationaux-socialistes des Sudètes, en particulier contre la population juive. Les entrepreneurs juifs ont été expropriés. En mai 1939, il n’y avait plus que 2 400 juifs dans le « Reichsgau Sudetenland », dont la plupart d’entre eux seront déportés dans des camps de concentration.

© Wolfgang Zabrzynski
Dans notre famille, Viktor Potaravsky a été porté disparu à partir de 1938, mais d’après les souvenirs de la camarade d’école déjà mentionnée, il a probablement pu s’enfuir en Angleterre. Malheureusement, les archives spécialisées (Arolsen Archives, Yad Vashem, Association of Jewish Refugees) ne contiennent aucune information supplémentaire concernant Viktor.
Il était donc devenu difficile pour Elisabeth de ne pas vivre sa vie en suivant les lignes de la haine tracées par les nationaux-socialistes. La séparation de son fiancé l’avait particulièrement affectée et elle devait en outre s’occuper de sa tante gravement malade, de sorte qu’elle souffrait entre autres d’insomnies permanentes et recevait un traitement neurologique. A partir du 13 décembre 1938, elle avait finalement un emploi auprès du maire de Troppau en tant que greffière.
Enfin, elle a été également séparée de sa sœur, dont le mari Herbert Zabrzynski (mon grand-père) devait travailler à partir de 1938 comme électricien à Jauer (l’actuel Jawor), à plus de 200 km de là, et a quitté Troppau avec sa famille.
Il semble que depuis janvier 1944, un groupe de prisonniers de guerre anglais passait régulièrement devant l’appartement d’Elisabeth dans la Lichtensteinstraße. Peut-être pensait-elle à ce moment-là que les nazis allaient bientôt perdre la guerre et qu’il serait possible d’entrer en contact avec son fiancé en Angleterre par l’intermédiaire d’un des prisonniers de guerre.
Le 31 mars 1944, peu après 7h30, l’événement fatal s’est produit : Elisabeth a couru derrière le groupe de prisonniers et a tenté, selon sa déclaration au juge d’instruction local, de remettre à un Anglais des papiers et des morceaux de carton représentant Hitler sur une potence et le drapeau anglais, car elle serait tombée amoureuse de cet Anglais et aurait voulu éveiller sa sympathie. Il est possible qu’elle ait pu détruire un message destiné à son fiancé en Angleterre et détourner l’attention de sa tentative d’entrer en contact avec lui grâce à cette version des faits.
Mais aucun contact n’a eu lieu avec les prisonniers ; elle a attiré l’attention du surveillant des prisonniers et de passants, elle a tenté de s’enfuir, mais les passants (tous des membres du parti national-socialiste) l’ont arrêtée et remise à la police secrète d’État (Gestapo).
Pas de pitié
Le parquet de Troppau a transmis la procédure à Berlin et là, le 10 mai 1944, le procureur du Reich Parrisius a demandé devant le Volksgerichtshof l’ouverture du procès principal contre Elisabeth Sztwiertnia pour le crime d’ « intelligence avec l’ennemi », conformément au § 91b du code pénal de l’époque. Le 14 juin 1944, elle est condamnée à mort pour cela ou pour « démoralisation de la Wehrmacht » (§ 5 de l’ordonnance sur le droit pénal spécial de guerre de l’époque). Les nazis utilisaient volontiers ces normes juridiques pour faire exécuter les « ennemis du peuple », même pour des faits mineurs bien que les normes prévoyaient également des peines moins lourdes pour les cas moins graves.
Elisabeth et sa sœur ont déposé au total trois demandes de grâce restées sans réponse. Au contraire, le ministre de la Justice du Reich a proclamé le 26 juillet 1944 l’ordre d’exécution de la condamnation à mort et – en plus – dans l’information du 1er août 1944 adressée au procureur général du tribunal du Peuple (Volksgerichtshof), le ministère a spécialement demandé une accélération de la procédure. Le 11 août 1944, Elisabeth est décapitée à la hache à la prison de Berlin-Plötzensee.
Dossiers et faits
En 1985, j’ai commencé des recherches sur la base des dernières lettres d’Elisabeth et je me suis renseigné auprès du Service central des administrations judiciaires des Länder pour l’élucidation des crimes nationaux-socialistes à Ludwigsburg (appelé ci-après « Service central »). Celui-ci a alors entrepris une enquête préliminaire, m’a fourni le jugement du Volksgerichtshof et a transmis la procédure contre le premier procureur du ce tribunal, Heinz Heugel, encore vivant et impliqué dans l’assassinat, au parquet du tribunal de grande instance de Berlin. La procédure contre Heugel a été aussitôt abandonnée pour cause d’incapacité de comparaître. Pour les autres auteurs, éventuellement encore en vie, le parquet de Berlin a contesté sa compétence. Il semblait donc que les responsables encore en vie étaient peut-être trop âgés ou pouvaient passer à travers les mailles du filet du fédéralisme pénal de la République fédérale d’Allemagne. Pourtant, j’avais toujours le sentiment que quelque chose n’allait pas.
Fin 2019, j’ai examiné une nouvelle fois les documents et pris rendez-vous en 2020 auprès de l’antenne du département B des Archives fédérales à Ludwigsburg. C’est là que les documents du « Service central » sont disponibles pour utilisation depuis 2000. Dans le dossier, j’ai dû reconnaître qu’en 1985, des documents essentiels comme les procès-verbaux d’interrogatoire ne m’avaient pas été remis et que les indications concernant d’autres participants au crime n’avaient pas été suivies. Depuis, je travaille sur un texte plus long qui décrit les responsables et leur mode de pensée, dans la mesure où il est encore possible de trouver des informations à ce sujet et qui cherche les raisons pour lesquelles le meurtre d’Elisabeth n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires.
Commémoration commune
Un jour, je trouverai peut-être des écoles et des autorités d’Opava et de la ville jumelée allemande de Bamberg que je pourrai convaincre de participer à un projet de mémoire pour Elisabeth et d’autres victimes de la justice terroriste nazie dans les Sudètes de l’époque, pour une commémoration commune de ceux qui n’étaient certes pas des résistants héroïques, mais qui, comme Elisabeth, ne voulaient pas haïr du jour au lendemain les gens qu’ils aimaient hier encore, qui évitaient de faire le salut hitlérien et voulaient peut-être continuer à croire en Dieu, mais en tout cas pas au Führer, et dont le courage ou le désespoir leur ont coûté la vie précisément pour cette raison.
Traduit par Annick et Christine Eckel