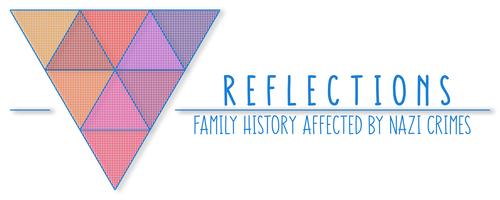Une famille comme les autres
Vous souvenez-vous du potage à l’orge mondé ? Ou aviez-vous aussi des oranges à la maison seulement pour Noël ? Nous avons eu notre premier téléphone quand j’avais dix ans. Il n’y avait que trois programmes de télévision. A midi, il n’y avait pas d’émission pendant trois heures. Et les programmes se terminaient, je crois, vers minuit avec l’hymne national.
Nous étions beaucoup d’enfants. Jouer et toute notre enfance se sont passés dehors. Nous jouions à « Geschichtenball » (la balle à histoires), à « Länder verteilen » (partage de pays), à la corde à sauter, à « Jungs die Mädchen » (garçons attrapent les filles), etc. Dans chaque famille, il y avait au moins trois enfants, c’était normal. Moins était l’exception. Ma mère était femme au foyer. Mon père était docker. C’était normal dans ma petite enfance.
Je suis née en 1964 et de telles histoires font sourire les personnes de mon âge. On en parle volontiers.
S’il n’y avait pas mon père
Ma fille, qui est née en 1995, aime m’écouter raconter. Elle rit souvent et pose beaucoup de questions. Dans ma jeunesse et mon adolescence, j’aimais aussi écouter mes parents. Comment était leur enfance et leur jeunesse ? Mes parents ont raconté que je leur ai posé beaucoup de questions, j’essayais de tout m’imaginer et je comparais ce que j’entendais avec ce que je vivais.
Souvent, leurs récits mentionnaient des privations : la faim, le manque de vêtements et de soins de santé ou la possibilité de poursuivre des études. Ma mère, née en 1927, était encore petite pendant la crise économique mondiale. Elle était écolière et adolescente à l’époque du nazisme.
Mon père, né en 1909, a vécu enfant la Première Guerre mondiale. Famine, rutabagas à tous les repas. Il ne portait des chaussures que le dimanche pour aller à l’église. Pour eux, l’ascension sociale par le biais d’études supérieures était impossible. L’enseignement supérieur était payant. Et mes grands-parents avaient besoin de cet argent pour nourrir leur famille. Les deux devaient rester dans leur couche sociale d’origine. Ma mère devait – selon l’idéologie nazie – devenir « mère ». Mon père national-socialiste et soldat.
Mais mon père en a décidé différemment. Il était antifasciste et s’est engagé dans la résistance. Il ne voulait ni haïr, ni tuer, ni se sentir supérieur à d’autres. Il était contre la guerre et la pauvreté.

Uta Kühl lors de son discours à l’occasion du « Volkstrauertag » (journée du deuil national) dans la Maison du recueillement du Mémorial de Neuengamme.© KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2015.
Etre exclu, même après la guerre
Quand je marchais dans la rue avec mon père, il ne passait pas inaperçu. Il ne portait pas de « pancarte », mais ses tatouages étaient visibles. Moi, je ne les voyais plus. Les tatouages étaient caractéristiques pour des marins, un groupe social de travailleurs peu considéré. J’ai été témoin de regards condescendants, parfois de commentaires méprisants. Aujourd’hui, ces tatouages sont courants. Presque tout le monde en a.
Plus tard, ce fut la période de la plainte pour réparation (« Wiedergutmachung ») pour avoir droit à une retraite. Je ne comprenais pas – pourquoi mon père devait-il porter plainte ?
Fort – en dépit de l’internement en camp de concentration
De 1939 à 1945, mon père avait été interné comme Schutzhäftling (« détenu de protection ») à Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Neuengamme, Dachau, Mauthausen, Gusen 1 et 2. Pour moi, il était évident que sa santé avait tellement souffert de ces longues et dures détentions en camp de concentration qu’il n’était plus capable de travailler.
Il a eu droit à une retraite minimale, a dû se battre longuement pour obtenir la retraite de « réparation ». Tout ça, il l’a fait sans avocat. Je le revois encore aujourd’hui assis à écrire des recours et pourvois. Et à nouveau, la réponse se faisait longtemps attendre. Et toujours et encore, le monde des camps le rattrapait. Son état de santé allait de plus en plus mal.
Retour en arrière : je devais avoir trois ans environ. Mon père avait bu de l’alcool. Il était sur le balcon et criait : « Vous m’avez envoyé dans les cam
ps de concentration. Mais regardez, je suis encore là. Je vis. » Ma mère disait : « Va, fais rentrer ton Papa, s’il te plait. » Je sortais, lui prenais la main. Mon père me regardait. Je lui disais : « Viens, rentre, Papa. Arrête de crier. » Il souriait et rentrait avec moi. Je n’ai rien oublié. Je ne peux en parler qu’avec certains d’autres « enfants », et entre-temps à ma fille qui est adulte aujourd’hui. Pourquoi c’est comme ça ?
Pour moi, il est important de ne pas présenter mon père comme quelqu’un de « petit » ou de « faible ». Il ne l’a jamais été. Bien qu’il ait su que les camps de concentration l’avaient changé. Je ne veux pas de pitié, tout au plus de la compassion, des conversations, des participations d’égal à égal.
Toujours présent
Pendant que la plainte pour réparation était en cours, notre vie, donc aussi ma vie, se poursuivait, bien que ce « combat » ait affecté notre vie de famille. Je me souviens par exemple : je rentrais à la maison, mon père était dans le couloir, une lettre à la main. Nos regards se rencontraient. De suite, je savais de quoi il s’agissait. « Papa, une lettre de l’office en charge des réparations ? » Il hochait de la tête, toussait (ses poumons étaient très touchés depuis le travail dans les mines à Gusen) et retournait abattu dans la salle de séjour. Je lisais. Encore un refus. Je ne pouvais pas croire ce qui était écrit. Maintenant, c’était moi qui avais envie d’aller sur le balcon et de crier : « Arrêtez de lui faire du mal ! Vous parlez à un résistant ! C’est clair ? »
Mais je ne le faisais pas. Je m’asseyais à côté de lui. « Papa, prends enfin un avocat, tu n’as pas besoin de te faire du mal. C’est ton droit. » « Ma petite, à qui dois-je le confier ? Ils sont tous passés par l’école nazie. » Je lui caressais le dos. Peu de temps après, il était assis et écrivait.
Mon père a souvent parlé de sa détention dans les camps de concentration. Parfois, il parlait parce que je lui posais des questions. Parfois, parce qu’il y avait des articles de journaux, une convocation pour témoigner à un procès d’après-guerre jugeant des nazis, une invitation à une commémoration de la libération à Neuengamme, etc. Mais parfois aussi parce qu’une sensation, une odeur, un bruit, un mot semblaient raviver des images intérieures de sa détention. Alors, il allait très mal.
Il m’a parlé de ces images. Je l’ai simplement écouté. Je restais à ses côtés jusqu’à qu’il aille mieux.
Un héritage important
Je me souviens de beaucoup de choses comme si c’était hier. Par exemple, quand j’avais quinze ans et qu’il m’a offert son document de libération, établi par les Américains. Il l’avait toujours porté sur lui jusqu’à ce jour. C’était très important pour lui. Et maintenant, c’est moi qui devais l’avoir. Nous en avons parlé. Il m’a expliqué qu’il n’en avait plus besoin. Je lui ai promis d’en prendre soin. Il a souri et m’a dit : « Je le sais ma fille et c’est pour cela que je te le donne. »

„Document de libération“ d’Hermann Kühl, établi par les Américains
Puis en jour, c’était enfin terminé. Après presque douze ans, l’office des réparations suivit le conseil du tribunal et proposa un arrangement. On attribua un avocat à mon père. Mon père accepta l’arrangement uniquement parce que sa santé se dégradait de plus en plus. Il n’aurait pas survécu d’autres années d’affrontement juridique.
Et ce fut ainsi. Même pas trois ans plus tard, il est décédé. Quelques jours avant, nous avons eu une longue conversation intense, clarifiante et proche. Il me dit : « Lorsque nous, les vieux, sommes morts depuis longtemps, vous, les jeunes, vous ne devez jamais oublier l’époque nazie, tu m’entends ?! Spécialement toi, en tant que jeunes Allemande. Plus jamais une guerre doit s’étendre à partir du sol allemand ! Fais tout ton possible. Parles aux gens. Soyez présents pour votre mère, prenez soin d’elle ! Elle avait une vie dure. Elle est votre mère ! »
On se tenait la main, quand je lui ai donné ma promesse de faire tout mon possible. Jusqu’à sa mort, nous étions là pour notre mère. Et je parle aux gens. Je pense souvent à mon père qui était un fier marin et résistant.
Traduit par Annick Eckel.