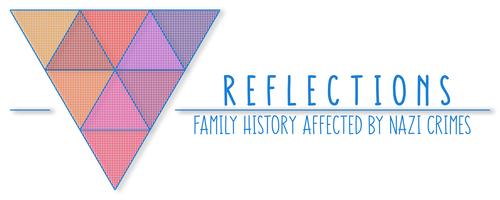UNION DES AMICALES DE CAMP DE CONCENTRATION OU INTERAMICALE
Depuis quelques années, les principales associations françaises de mémoire des camps de concentration ont à cœur de travailler ensemble et de mener des projets communs. C’est dans cet esprit qu’elles ont notamment apporté leur concours à l’Union des Déportés d’Auschwitz pour l’élaboration d’un site internet intitulé Mémoires des Déportations, sur lequel figurent de très nombreux témoignages de déportés originaires de France.
Afin de mettre en œuvre cette coopération renforcée entre elles, les amicales ou associations des camps de Buchenwald-Dora, Dachau, Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück et Sachsenhausen ont créé une Union des amicales de camp de concentration ou Interamicale, qui est à ce stade une structure informelle mais pourrait bientôt acquérir une existence juridique. L’Interamicale, composée de responsables des six associations, tient des réunions régulières et agit dans le cadre d’initiatives conjointes telles que la tenue d’un stand commun et l’organisation d’une table ronde dans le cadre des Rendez-vous de L’Histoire à Blois, tant en 2016 qu’en 2017, ou encore l’invitation à des journées communes, en 2015, et de nouveau tout récemment, les 26 et 27 novembre 2017.
Ces deux journées se sont déroulées autour du thème, choisi d’un commun accord, des procès de l’après-guerre conduits par les autorités d’occupation contre les criminels nazis. Le 26 novembre, des membres des amicales ont analysé la manière dont ces procès ont été perçus, à l’époque, au sein de chaque association. C’est dans ce cadre qu’a eu lieu l’intervention de Jean-Michel Gaussot, préparée sur la base des recherches effectuées par’Yvonne Cossu, dont le texte figure ci-après.
Le 27 novembre, les adhérents des amicales se sont retrouvés à l’Institut Historique Allemand de Paris pour entendre des historiens des deux pays évoquer les procès menés par les tribunaux militaires des différentes zones d’occupation. S’agissant de la zone britannique, Lars Hellwinkel a rendu compte des procès du Curiohaus, de Brême et de Lüneburg.
LES PROCES DES CRIMINELS NAZIS VUS PAR L’AMICALE DE NEUENGAMME
L’attitude des anciens déportés de Neuengamme – et donc de l’amicale qu’ils ont fondée – à l’égard des procès des bourreaux nazis peut se résumer en deux formules : une forte exigence de justice, et une réelle frustration devant des condamnations jugées trop clémentes et trop peu nombreuses.
Une forte exigence de justice
Cette exigence se manifeste dès la création, en septembre 1945, de l’Amicale de Neuengamme et de ses Kommandos. Elle est clairement exprimée dans les statuts de l’association qui, parmi les buts assignés à celle-ci, mentionnent en tout premier lieu la volonté
« d’honorer la mémoire des déportés assassinés ou disparus en camp de concentration ou depuis leur retour, de dénoncer la barbarie de leurs bourreaux et de tous leurs complices, d’aider à leur identification et à leur châtiment. »
En avril 1946, l’Amicale tient son premier congrès : elle réaffirme à cette occasion sa demande que justice soit faite en adoptant un « Serment à nos camarades tombés chez l’ennemi » dans lequel figure cet engagement :
« Nous jurons que soient justement châtiés vos bourreaux et que soient mis hors d’état de nuire, tant que nous vivrons, les tyrans de notre patrie ».
Il est intéressant d’observer que ce texte a été adopté alors même que se tenait, au Curiohaus de Hambourg, le premier procès de responsables du camp central de Neuengamme, qui, ouvert à la mi-mars, s’est conclu le 3 mai – date symbolique puisque c’était le premier anniversaire de la tragédie de la Baie de Lübeck qui avait coûté la vie à 7000 déportés de Neuengamme. L’Amicale adressa d’ailleurs un télégramme au tribunal britannique de Hambourg ainsi qu’au Tribunal de Nuremberg pour leur demander de prononcer sans délai des verdicts implacables. Le procès du Curiohaus s’est conclu par la condamnation à mort de 11 des 14 accusés (dont celle du dernier commandant du camp, Max Pauly). Les 3 autres se virent infliger des peines de prison allant de 10 à 20 ans, qu’ils ne purgèrent d’ailleurs qu’en partie, en raison des libérations anticipées dont ils bénéficièrent.
A notre connaissance, deux déportés français ont témoigné lors de ce procès organisé par les autorités militaires britanniques, le général de Grancey et le premier président de l’Amicale de Neuengamme, Marcel Prenant. Voici quelques extraits de la déposition du second, faite au septième jour du procès, le 25 mars 1946.
Interrogé sur les conditions de déroulement du transport ferroviaire de Compiègne à Neuengamme, il répond :
« Quand je suis arrivé de France, j’ai eu trois jours de voyage et nous étions 120 personnes entassées dans un seul wagon sans aucune possibilité de dormir et sans une goutte d’eau, et c’était pendant l’été. »

Quatre anciens déportés à Hambourg en 1946: Hans Schwarz, Harold Osmond le Druillenec, Marcel Prenant et Albin Lüdke (de gauche à droite). © apabiz.
Il souligne ensuite que dès la descente du train, puis durant toute leur détention, les déportés étaient fréquemment frappés et précise :
« Je dirais que c’était un système, non seulement de battre les prisonniers, mais de les faire mourir lentement ».
Et il ajoute que
« tout était fait au camp dans le but d’affaiblir le plus possible les prisonniers ».
Marcel Prenant évoque aussi devant les juges militaires britanniques la situation particulièrement abominable qui prévalait au Revier, c’est-à-dire dans ce qui tenait lieu d’infirmerie et qui, dit-il, fonctionnait souvent comme un
« camp d’extermination ».
D’autres déportés français ont vraisemblablement témoigné dans des procès ultérieurs, concernant en particulier les Kommandos extérieurs. Mais nous n’en connaissons que deux : Pierre Maurice Restoueix, déporté au Kommando de Salzgitter-Drütte, qui témoigna lors d’un procès au Curiohaus en mars / avril 1947,* et René Menu, déporté de Fallersleben qui, quelques années plus tard, envoya son témoignage écrit à la justice danoise appelée à juger l’un de ses ressortissants, Callesen, qui était l’adjoint du commandant de ce camp annexe de Neuengamme.
Il faut aussi remarquer que l’exigence d’une justice sévère qui anime les déportés ne s’applique pas seulement aux bourreaux allemands mais concerne également leurs collaborateurs français. Ainsi, l’Amicale adresse, en août 1946, une lettre ouverte au ministre de la Justice, Paul-Henri Teitgen, pour protester contre la mansuétude excessive dont bénéficient, selon eux, trop de traîtres à la patrie. Les auteurs y dénoncent, je cite,
« les remises de peine, les grâces scandaleuses, les mises en liberté provisoire, les acquittements ».
« Contre la trahison »,
proclament-ils,
« un seul châtiment : la mort ».
Les adhérents de l’Amicale voient dans ces décisions en faveur des accusés un « sabotage de l’épuration », expression que l’on retrouve dans plusieurs de leurs déclarations. Cette insistance pour que justice soit faite, l’Amicale la réitère à plusieurs reprises dans les années 50. Lors de son 5ème congrès, en juin 1954, elle adopte une résolution dans laquelle elle
« s’élève avec la dernière vigueur contre la lenteur de procédure après dix années d’instruction qui n’ont pas encore abouti au châtiment des bourreaux nazis »
et
« stigmatise avec énergie les mesures de clémence et d’oubli dont bénéficient les tortionnaires condamnés et leurs collaborateurs. »
Un an et demi plus tard, en décembre 1955, une nouvelle résolution condamne « les remises de peine et les libérations des bourreaux nazis et de leurs complices français blanchis par la Haute Cour et les tribunaux militaires
Une réelle frustration
Comme je l’ai observé en commençant, cette forte exigence de justice des déportés a été largement déçue. Quelques mois après le premier procès du Curiohaus, Marcel Prenant lui-même fait état de cette déception, dès août 1946, dans le bulletin de l’Amicale, N’oublions jamais, regrettant que certains accusés aient échappé à la peine capitale. Il conclut son article par ces mots :
« Ne pensez-vous pas que c’est prendre beaucoup de précautions et que tous les quatorze accusés auraient bien pu faire quatorze pendus ? »
Il formule le même regret dans son livre «Toute une vie à gauche », publié en 1980 : rappelant l’issue du procès auquel il prit part, il conclut :
« C’est peu pour tant de crimes ! »
L’insatisfaction des déportés ne tient pas seulement à l’indulgence des juges du procès de 1946 à l’égard de 3 des 14 accusés, qui échappèrent à la peine capitale. Au-delà de ce premier jugement, elle s’explique par le fait que trop peu de responsables aient été traduits en justice. Les procès de Hambourg ont, en effet, épargné de nombreux criminels nazis, SS et Kapos, qui ont sévi au camp central et, plus encore peut-être, dans les Kommandos extérieurs.
Il est vrai que les déportés de Neuengamme, informés par leur président du procès initial, ne l’ont pas toujours été des jugements qui ont suivi. On ne trouve guère de mentions, dans leurs écrits, de ces procès ultérieurs et du fait qu’au total 445 hommes et 55 femmes furent jugés au Curiohaus, que plus de 100 furent condamnés à mort cependant que 262 se virent infliger de simples peines de prison**. La circulation de l’information n’était évidemment pas ce qu’elle est aujourd’hui. Mais eussent-ils connu ces chiffres, leur frustration n’en aurait sans doute pas été moindre : le pourcentage des condamnations à mort leur serait certainement apparu comme beaucoup trop faible.
La déception des déportés résulte aussi de la non-satisfaction de leur demande corrélative de réparations, formulée conjointement avec celle d’une justice impitoyable. L’ancien déporté Jean-Aimé Dolidier, premier président de l’Amicale internationale de Neuengamme, avait formulé ainsi cette double exigence dans le bulletin de l’association :
« Nous avons trop souffert pour avoir de la pitié et nous réclamons à nouveau JUSTICE pour tous les coupables et REPARATIONS par les profiteurs de notre travail. »
Aujourd’hui encore, plus de sept décennies après les faits, une certaine frustration perdure, même si elle s’est quelque peu atténuée avec le temps. Beaucoup, parmi les survivants et leurs descendants, nourrissent le sentiment que justice n’a pas été faite, pas pleinement en tout cas. (Avec une nuance de taille cependant : la peine de mort, abolie en France comme en Allemagne, n’est généralement plus perçue aujourd’hui comme un élément indispensable d’une justice efficace). S’ajoute à ce sentiment d’incomplétude la constatation amère qu’il est maintenant trop tard, que trop de criminels sont morts de mort naturelle sans avoir été véritablement inquiétés, sans avoir été jugés comme ils auraient dû l’être. Et, au-delà du cas de Neuengamme, cela vaut à l’évidence pour tous les camps et pour l’ensemble des crimes nazis.
La plupart de nos adhérents partagent certainement le jugement d’un ancien déporté de Neuengamme, l’écrivain et journaliste Louis Martin-Chauffier, qui, dans un article publié en octobre 1974 dans Le Patriote Résistant, évoquait le procès de Nuremberg en ces termes :
« Justice de vainqueurs », a-t-on dit. Il est vrai qu’il a fallu la victoire – tardive et remportée de justesse – pour que justice, bien incomplète, fût rendue. Mais il ne s’agit pas ici d’abord de vainqueurs et de vaincus. Il s’agit de crimes, de criminels monstrueux, auxquels la guerre a servi longtemps pour accomplir le plus effrayant attentat contre l’espèce humaine que des hommes pleinement responsables aient jamais conçu et réalisé. […]Des témoins sont venus, dont Marie-Claude Vaillant-Couturier, rescapée de Ravensbrück, bouleversante de clarté et d’émotion maîtrisée. Des juristes – Edgar Faure, le procureur français Gerthoeffer – ont démontré la justice de l’accusation contre le crime institutionnel. Et pourtant, Schacht et von Papen ont été scandaleusement acquittés, d’autres condamnés à des peines de prison, qu’ils n’ont d’ailleurs pas purgées jusqu’au bout. C’est peut-être là, dans cette justice inconsidérément distributive, qu’il faut chercher la raison, au bout du compte, du peu d’effet durable produit par cette gigantesque mise en scène. Les crimes contre l’humanité sont répétés sur toute la surface du globe. Et combien de régimes sanglants sont inscrits à l’ONU. Et combien ont signé la charte des Droits de l’Homme avec la même négligence que Hitler et Mussolini quand ils avaient paraphé cet autre « chiffon de papier », l’accord de non-intervention dans la guerre d’Espagne. Il reste pourtant que le principe du génocide a été défini, plus ou moins appliqué, reconnu par les institutions internationales. Une goutte d’eau dans le désert, est-on fondé à dire. Mais une goutte d’eau prouve que l’eau existe, si elle ne suffit pas à désaltérer un seul homme. Quand sera-t-il possible de forer les fontaines qui l’aideront à ruisseler ? »
*Voir Dossier de Neuengamme n° 1, « Le Kommando de Salzgitter-Drütte », p. 27.
**Source : Catalogue de l’exposition « Les procès du Curiohaus à Hambourg », Hôtel de ville de Hambourg, janvier 2017 (panneau 42).